Un seul lit pour plusieurs rêves
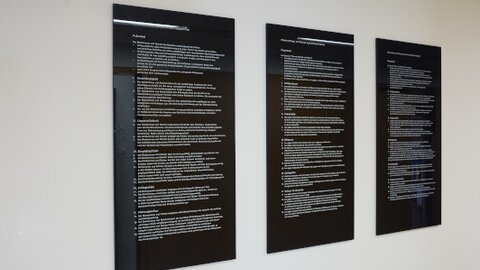
Dès son préambule, la Charte éthique évoque la collaboration entre juges. Elle y revient ensuite en ses articles 12 et 14. Il ne suffit toutefois pas d’écrire quelque chose dans la Charte éthique. Encore faut-il le vivre concrètement au quotidien.
Les juges doivent présenter une disposition à la collaboration, ce d’autant qu’ils sont choisis en raison de leur diversité d’origine, de langue, de sexe, de culture, d’opinions politiques et d’autres critères encore. Si le tribunal veut fonctionner correctement les juges doivent être en mesure de surmonter les différences qui existent entre eux. Certes, la loi impose un certain nombre de choix et la jurisprudence coordonnée également ; la subjectivité d’un juge ne peut pas ignorer ces requis (la Charte éthique le rappelle à son article 3). Mais là où la loi laisse une marge d’appréciation, la subjectivité du juge doit prendre sa place (ce qu’un ancien président du Tribunal fédéral a appelé « sein Vorverständnis »). Telle est la volonté du législateur.

PARCOURS PERSONNEL
Gérald Bovier est juge au tribunal administratif fédéral depuis 2007. Il travaille à la Cour IV, qui statue sur les affaires relevant du domaine de l’asile. Suite à ses études, il a obtenu une licence en droit bilingue (français/allemand) à l’Université de Fribourg. Il est également titulaire d’un brevet d’avocat ainsi que d’un diplôme de notaire, tous deux du canton du Valais.
On le sait. Il y a des domaines juridiques où le pouvoir d’examen réservé au juge est plus large. La discussion publique a mis en évidence le domaine de l’asile. En effet, la loi sur l’asile fait appel à des notions indéterminées comme la vraisemblance, le caractère raisonnable ou l’exigibilité. Les juges sont donc amenés au quotidien à donner un contenu à de telles notions indéterminées. Il appartient aux juges dans les collèges de trouver des solutions adaptées à chaque situation. Dès lors que des différences d’appréciation peuvent exister, on en a rapidement déduit que le domaine de l’asile était un champ de politisation. Les médias, l’opinion publique et plus récemment l’université ont fait leur l’idée qu’une politisation était à l’œuvre, alors que sont en cause des différences de cultures et de personnalités. La tendance actuelle est de dénoncer cette politisation de manière unilatérale en mettant en évidence certains que l’on a soigneusement isolés pour mieux les dénoncer. Le simple fait toutefois que l’on exerce différemment son pouvoir d’appréciation n’est pas déjà un signe de politisation. Ce constat vaut d’ailleurs pour tous les points de vue qui s’expriment.
«La seule culture que nous devons pratiquer au tribunal est celle du dialogue.»
Gérald Bovier
Aujourd’hui, il faut prendre garde à ne pas céder à une tendance qui nous vient des Etats-Unis et qui tend à discréditer d’emblée certains et à en sacraliser d’autres. Ce que l’on nomme la culture de l’effacement (cancel culture) n’est pas une culture. La seule culture que nous devons pratiquer au tribunal est celle du dialogue. Même si déjà la tentation à l’effacement a atteint l’Europe dans certains médias, dans certaines universités et dans un certain débat public. Notre tribunal ne peut fonctionner que s’il accepte que chacun de ses membres est légitime lorsqu’il respecte la loi et la jurisprudence coordonnée.
Il n’y a qu’un seul lit pour plusieurs rêves, c’est celui du dialogue et du respect mutuel. Cela exige de nous indépendance d’esprit, modestie et autocritique. C’est ce que je souhaite à notre tribunal pour qu’il puisse continuer à remplir pleinement son rôle en pratiquant une justice indépendante.
Plus d'articles de blog
Plus que jamais, la Charte éthique est nécessaire
Gérald Bovier, juge à la Cour IV, nous parle de l’importance de la Charte éthique du Tribunal administratif fédéral.
Entre le travail et la famille
Michela Bürki Moreni, juge à la Cour III, sait bien ce que signifie concilier une carrière et des enfants entre trois cantons et deux régions linguistiques.
